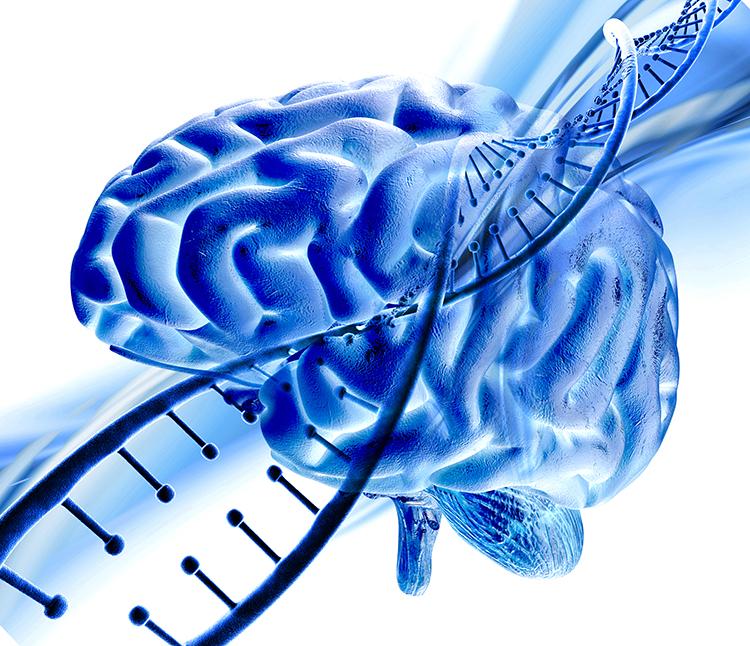A l’UdI, nous sommes très attentifs aux évolutions pédagogiques qui nous permettent d’optimiser la montée en compétence de nos apprenants. Les avancées en neurosciences cognitives ont permis de mieux comprendre comment nous apprenons, et nous essayons de nous appuyer sur leurs apports pour faire progresser nos pratiques.
Nous avons découvert ce podcast passionnant de France Culture « Les neurosciences peuvent-elles rendre les apprentissages plus efficaces ? » et décidé de vous faire partager ce que nous en avons retenu les meilleurs spécialistes du sujet, Edouard Gentaz, professeur de psychologie du développement, Grégoire Borst, professeur à l’Université Paris Cité, Frédéric Guilleray, enseignant de Sciences de la vie et de la terre au lycée (Académie de Versailles), formateur, chargé de mission au conseil scientifique de l’éducation nationale et Anaïs Roux, psychologue, experte en neurosciences, nous ont livré des clés d’analyse précieuses.
En effet, deux notions centrales émergent : la consolidation, soit le renforcement progressif des apprentissages dans la mémoire à long terme, et l’autonomie, c’est-à-dire la capacité de l’apprenant à s’auto-réguler dans ses apprentissages. Ces deux leviers sont essentiels, tant à l’école que dans le cadre de la formation professionnelle, où l’apprenant adulte est de plus en plus acteur de son parcours.
Consolidation : apprendre, c’est répéter… au bon moment
Stanislas Dehaene, neuroscientifique et président du Conseil scientifique de l’Éducation nationale, rappelle que le cerveau humain a besoin de répétitions espacées pour ancrer durablement les savoirs. Il ne suffit pas de comprendre une notion une fois : c’est l’effort de rappel, réparti dans le temps, qui solidifie l’apprentissage.
Dans le cadre de la formation continue, cela plaide pour des formats hybrides qui permettent de revenir régulièrement sur les connaissances-clés : micro learning, coaching à distance, quiz de renforcement, mises en pratique étalées dans le temps… Autant de modalités qui soutiennent la consolidation active.
À retenir : une formation efficace ne se joue pas seulement au moment de la transmission, mais dans le « après » — ce qu’on répète, revoit, applique.
L’autonomie cognitive : un enjeu pour l’école comme pour l’adulte apprenant
Les neurosciences montrent aussi que l’apprentissage est plus efficace lorsque l’élève ou le stagiaire est actif et engagé, et non passif. Cela passe par l’autonomie cognitive : comprendre comment on apprend, savoir mobiliser des stratégies, se fixer des objectifs.
C’est le sens du programme ATOLE (ATtention à l’écOLE), porté par Jean-Philippe Lachaux, chercheur à l’INSERM, qui vise à apprendre aux élèves à mieux gérer leur attention. Une compétence de plus en plus cruciale à l’heure des distractions numériques – et tout aussi valable en formation professionnelle.
Former les adultes, ce n’est pas seulement transmettre un contenu, c’est aussi leur donner les moyens de s’auto-réguler, de planifier leur progression, de prioriser l’information pertinente, et de comprendre leur propre fonctionnement cognitif.
À retenir : l’autonomie n’est pas une condition préalable à l’apprentissage, c’est une compétence qui s’apprend et se cultive.
Vers des environnements d’apprentissage plus adaptés pour accompagner la montée en compétence
Dans le monde professionnel, ces enseignements nous invitent à :
Structurer les formations dans le temps, avec des temps de réactivation, de feed-back et d’ancrage.
Accompagner les apprenants dans la métacognition (apprendre à apprendre).
Intégrer des modalités variées (autonomie, tutorat, collectif), pour renforcer l’engagement actif.
Valoriser les temps de mise en pratique, qui jouent un rôle clé dans la consolidation.
Le passage d’un modèle transmissif à un modèle plus expérientiel, réflexif et itératif est donc soutenu scientifiquement. L’enjeu ? Une formation plus durable, plus engageante et plus transférable.
Et c’est aussi ce que nous essayons de mettre en place à travers nos partis-pris pédagogiques et nous outils qui accompagnent les apprenants avant et après leur formation.
Pour écouter le podcast : rendez-vous sur https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/etre-et-savoir/quel-est-l-apport-des-neurosciences-a-l-ecole-6897946